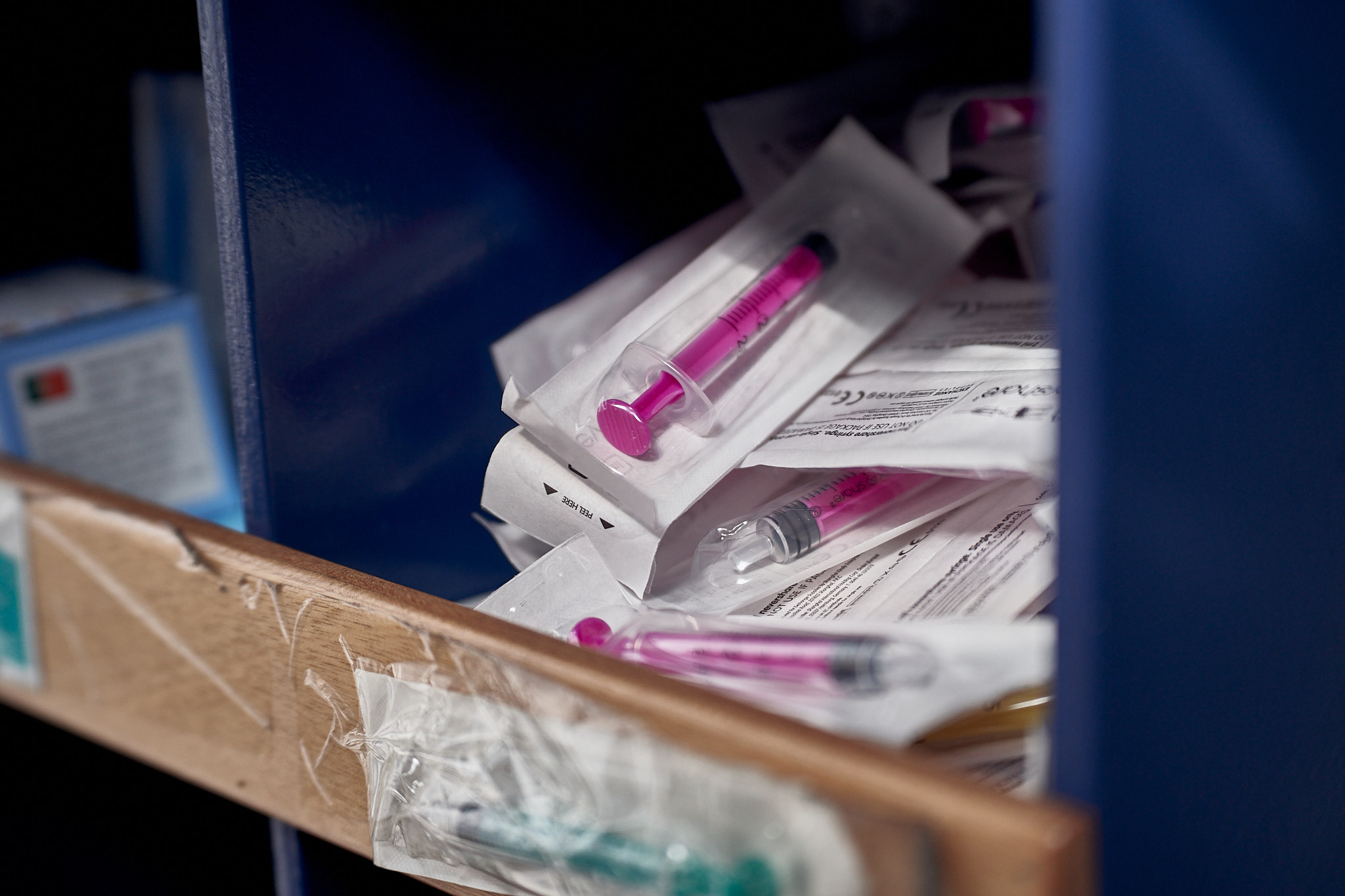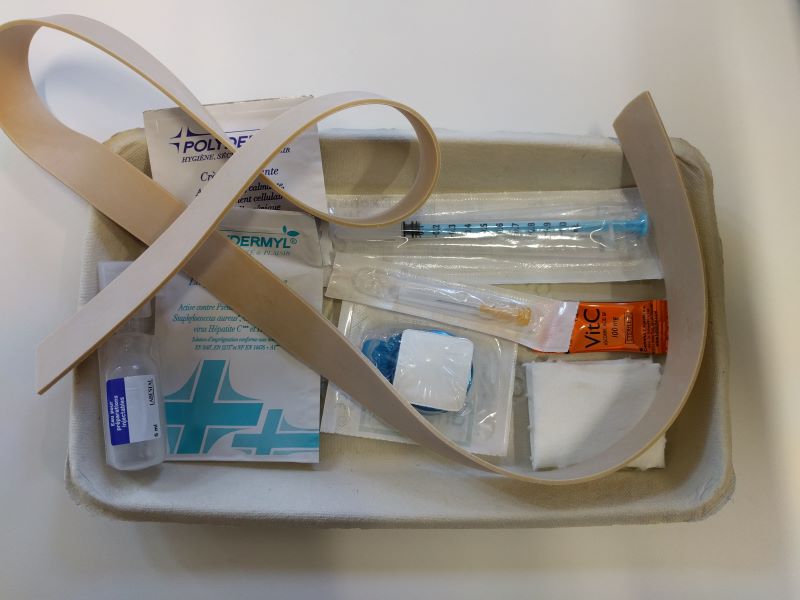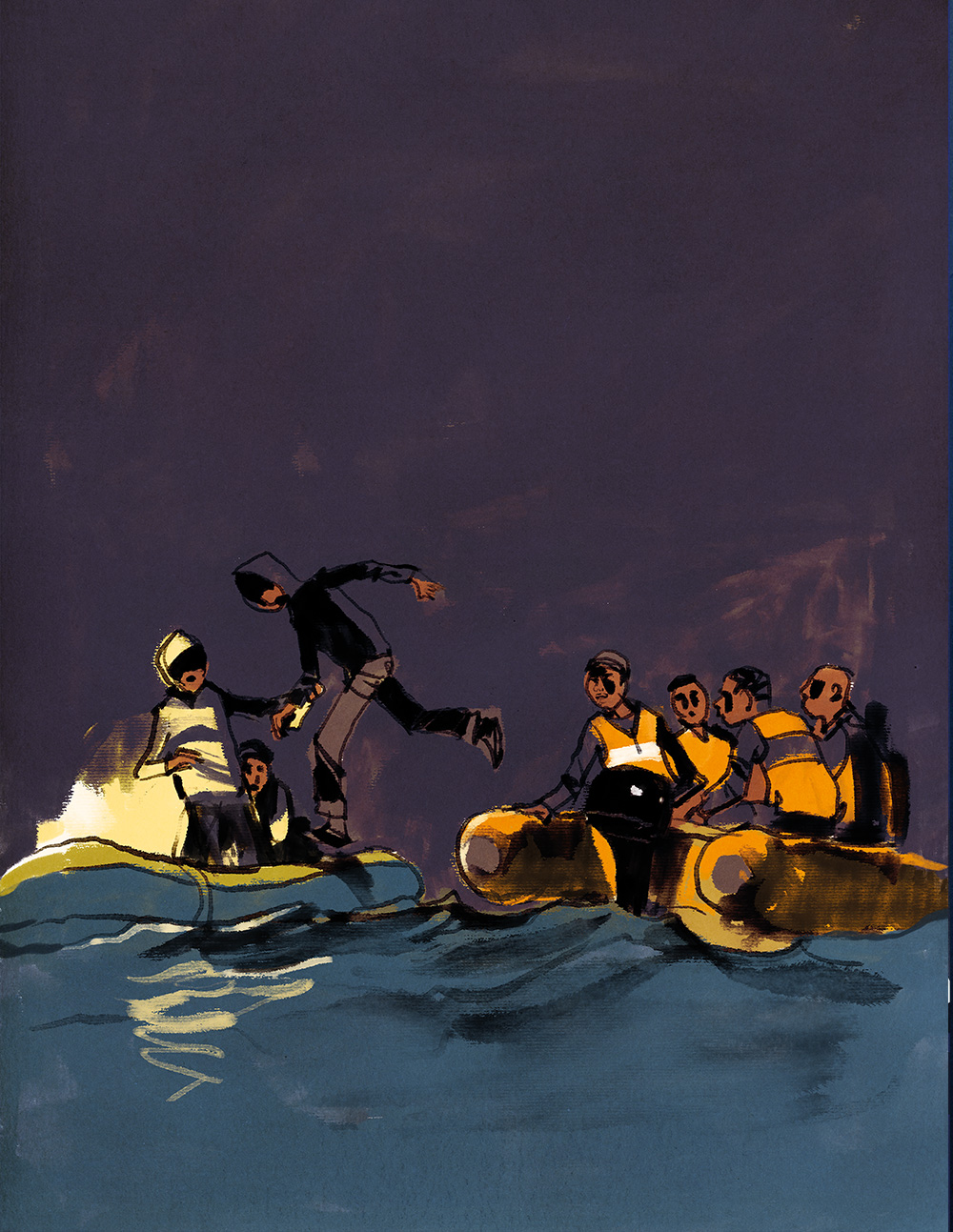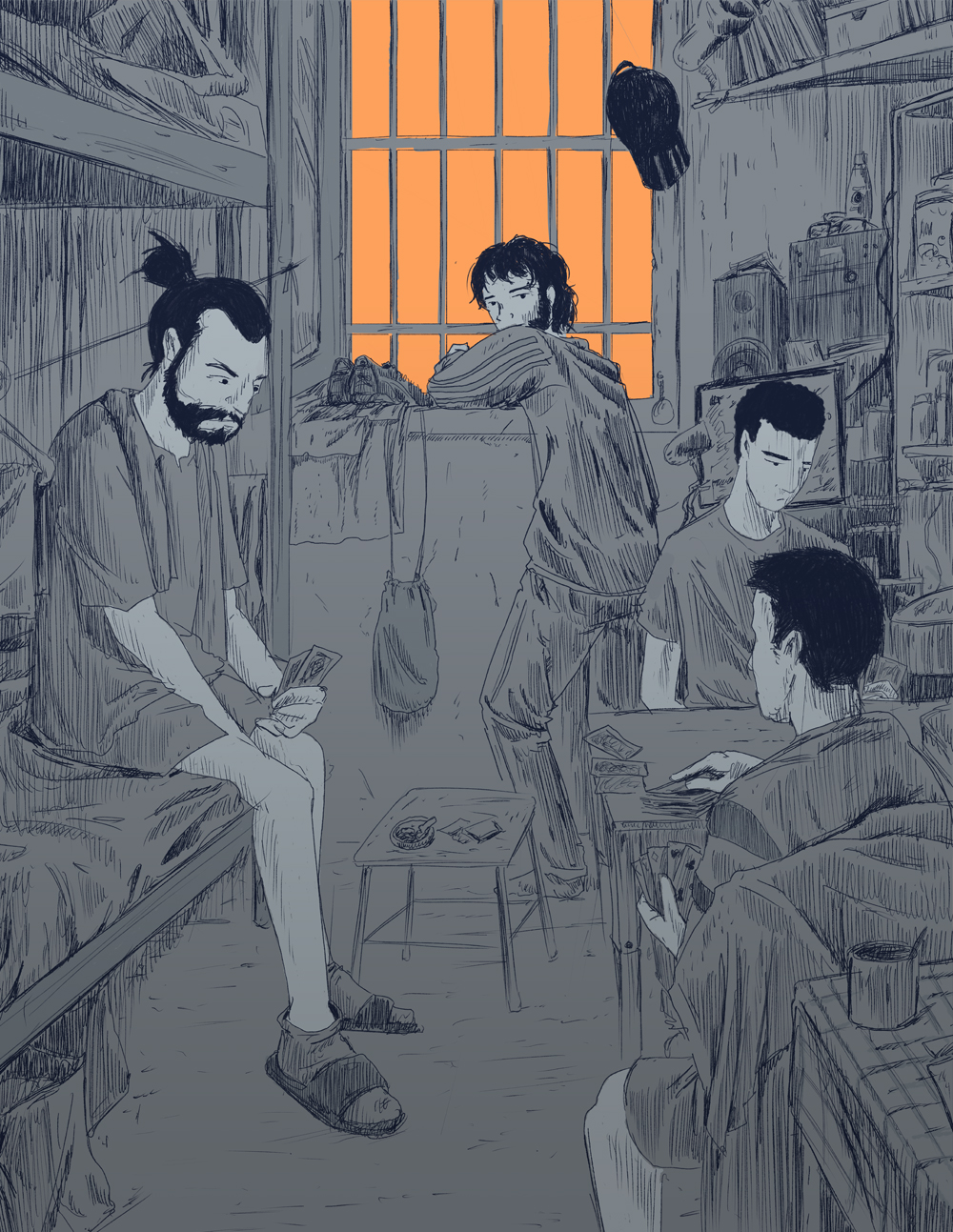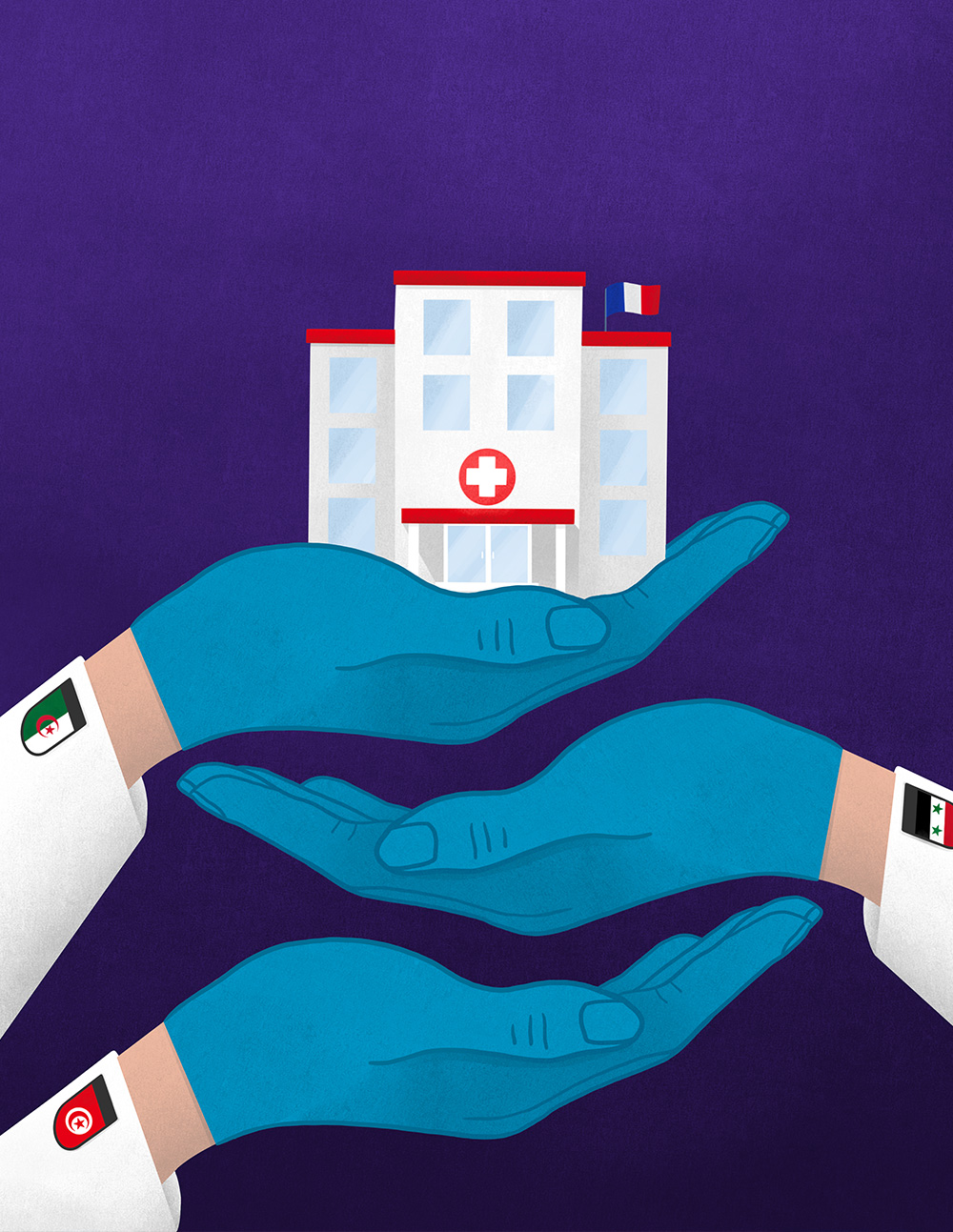Les salles de consommation ne sont pas légales en France. Des usagers de drogues sont montés sur scène pour raconter leur quotidien et la nécessité d’ouvrir ces lieux d’accueil à Marseille.
MARSEILLE EN MANQUE DE SALLE DE SHOOT
Quand la ville ignore ses toxicomanes
Une enquête sur scène présentée par
Regarder l’intégrale (1:04)

Nos partenaires de Marsactu montent sur scène. Marseille devait faire partie des villes test. Pourtant, voilà des années que la question d’une salle de shoot dans la deuxième ville de France est repoussée. L’accueil et l’aide aux toxicomanes dans le centre provoquent toujours des réticences.
Les épisodes
Aller plus loin

Marseille en manque de salle de shoot
Sophie M. : «Quand tu es en foyer, tout le monde en prend»
Avant de monter sur scène pour témoigner, Sophie nous a raconté son parcours. Comment elle est devenue toxicodépendante et milite pour une salle de shoot à Marseille.

Marseille en manque de salle de shoot
Le mirage de la salle de consommation
Le projet de salle de shoot est dans les cartons depuis 2015. C’était sans compter sur les résistances politiques.

Marseille en manque de salle de shoot
Communication brouillée
À Marseille, la mairie du 1er et 7e arrondissement s’inquiète d’un projet de « salle de shoot », selon les informations de Marsactu.

Marseille en manque de salle de shoot
Halte Soins Addictions : les riverains manifestent leurs craintes
Depuis l’enquête de Mediavivant et Marsactu, un nouveau lieu pour la « salle de shoot » a été annoncée à Marseille. Les habitants s’inquiètent, malgré les mesures de précaution annoncées.

Marseille en manque de salle de shoot
Ces lieux d’accueil permettent de diminuer les overdoses
Depuis la mise en place de « salle de shoot » expérimentale, des chercheurs ont publié des résultats positifs après cinq ans d’enquête.

Marseille en manque de salle de shoot
Quai n°9, l’accueil des usagers de drogues à Genève
Une salle de shoot existe à Genève depuis 22 ans déjà, en plein centre ville.